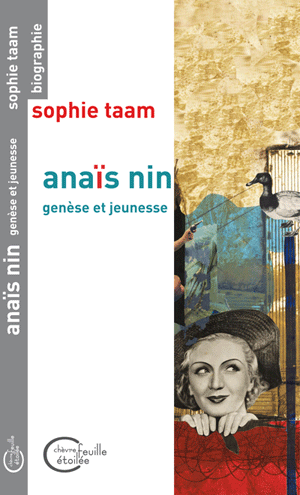Réflexion sur l’évolution linguistique en France concernant le genre.
Depuis quelque temps, nous assistons à des frémissements particulièrement intéressants de la langue française, et qui, étrangement, ont fait écho à mes questionnements pendant que je traduisais, courant 2017, Through the Flower – Mon combat d’artiste femme, l’autobiographie de Judy Chicago, de l’anglais au français.
Ils portaient essentiellement sur la féminisation des noms de métiers. En effet, en anglais, première différence, les substantifs sont neutres : le pronom défini est the et indéfini a ou an devant une voyelle (comme an artist, an author). Ainsi, les substantifs, contrairement au français, n’affichent pas la marque du genre. Secundo, la plupart des noms de métiers artistiques en anglais sont neutres : ainsi de writer, qui correspond à écrivain et écrivaine, artist, pour artiste, painter, pour peintre, author pour notre auteur et auteure/autrice. Sculptress est utilisé par Judy Chicago, mais c’est un mot anglo-saxon assez courant.
La grammaire, évidemment, possède une valeur symbolique. En français, contrairement à l’anglais, le symboliquement neutre n’existe pas. Certes, le nom « artiste », par exemple, ne porte pas de marque du genre, mais le pronom indéfini qui le précède, si : une artiste, un artiste. Lorsqu’on lit en français le mot « peintre », on visualise inconsciemment un homme, et non une femme. Poids de la langue et de la tradition.
Pour le mot peintre, j’ai utilisé : une peintre, ou une femme peintre, même s’il existe effectivement le mot peintresse, mais qui est si inusité qu’il aurait détonné dans le texte français. Artiste a aussi été relativement inoffensif. Sculptress en revanche m’a plongée dans des abymes de réflexion : j’ai finalement choisi sculpteuse, plutôt que de laisser sculpteur ou d’employer sculptrice, sans parler de sculpteure, qui sont tous deux des nouvelles venues dans la terminologie française.
Avec Through the Flower, j’ai été confrontée à un double défi : non seulement traduire des noms de métiers qui, neutres en anglais, ne le sont pas en français, mais également tenir compte du fait que cet ouvrage a été initialement publié en 1975 aux États-Unis. Un dilemme s’offrait donc à moi, dilemme qui se pose à tous les traducteurs et traductrices traduisant des ouvrages non contemporains (et qui, au fond, reflète le dilemme fondamental du traducteur) : respecter la période du texte original ou bien s’adapter à l’époque de parution de la version française ? Ce questionnement s’avérait d’autant plus aigu pour cet ouvrage que Judy Chicago était une féministe avant-gardiste, qui, si elle avait été française et avait écrit cette autobiographie en 2018, aurait probablement utilisé l’arsenal le plus pointu de la féminisation des noms.
Mais ce n’était pas le cas, et il me semblait que, pour respecter l’esprit de l’autobiographie, je ne pouvais pas employer de termes français trop récents, sous peine de commettre des anachronismes flagrants. Même si, en toute sincérité, je dois admettre que cette audace aurait certainement été pertinente avec la démarche de Judy Chicago, Néanmoins, ce qui me retenait, c’était l’idée que cette autobiographie constituait certes un manifeste féministe, mais aussi — et surtout, à mes yeux — un objet littéraire, un récit fluide, et je ne voulais surtout pas gâcher cette fluidité par des termes datés précisément ou des tournures polémiques et définitivement placées dans l’actualité contemporaine (comme l’écriture inclusive).
Les termes définissant en français la personne qui écrit témoignent d’une façon emblématique des tergiversations sociales et linguistiques qui se sont produites ces cinquante dernières années en France. Les prémices ont été plutôt lents et progressifs : ainsi, écrivaine, apparu environ dans les années 80, est le premier des mots féminisés à avoir été digéré par le français et être plus ou moins entré dans les mœurs.
Auteure est un peu plus récent. Il a été introduit en France au début des années 2000.
À noter que ces deux termes viennent du Québec, qui, comme chacun le sait, assume depuis longtemps sa radicalité sur les questions de féminisme.
2017 a donné naissance à autrice, et surtout à l’écriture inclusive, connue désormais de tou.te.s, qui a fait et continue de faire polémique.
Il semblerait que récemment, les frémissements se soient mués en véritables remous, accompagnant (anticipant, suivant ?) la vague des révélations #MEETOO et de toutes les libérations de parole marquantes des femmes au cours de ces deux dernières années.
Ce qui m’intéresse ici n’est pas de jeter de l’huile sur le feu déjà brûlant du débat lié à la féminisation des noms de métiers et à l’écriture inclusive, mais de prendre un instantané d’une période particulièrement riche et foisonnante du point de vue de la langue et, par extension, de la société française.
Cet instantané révèle des couches de la langue française qui se côtoient actuellement d’une manière inédite, me semble-t-il, dans l’histoire, chacune marquant un parti-pris ou une inertie — l’absence de parti-pris étant un parti-pris par défaut. Un prisme certes féministe, mais aussi temporel : projection dans le passé ou l’avenir. Et dans l’espace, puisque l’espace est parfois lié au temps, comme par exemple les termes introduits en France par le Québec, qui possède deux ou trois générations d’avance sur les questions du genre et du féminisme. Je constate désormais régulièrement, dans des échanges de mails avec plusieurs correspondant.e.s, que certain.e.s utilisent l’écriture inclusive, d’autres pas. D’autres, enfin, semblent éviter les tournures genrées et s’en tenir aux formules neutres (exemple : bonjour en début de mail plutôt que le chers/chères/cher.e.s problématique).
Judy Chicago, sous la plume d’une critique d’art engagée, est devenue sculpteure. L’écriture inclusive finira-t-elle par s’imposer dans la langue française, quid du terme autrice, ou auteure, des termes chercheuse ou chercheure, sculpteuse, sculpteure ou sculptrice, utilisés par l’un.e ou l’autre sur un même projet ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c’est que la langue française n’a jamais été aussi mouvante, émouvante, frémissante, une langue qui se cherche comme un.e adolescent.e, dans une époque qui a fait voler les certitudes du patriarcat en éclat.
Certains vivent déjà demain, le demain réel ou fantasmé d’une société consciente et engagée, où les racines du patriarcat auront été sapées par les remises en question successives.
Et d’autres vivent au siècle dernier. Rigoureusement étanches aux débats sociaux actuels. Ainsi, quelle n’a pas été mon hilarité, lorsque, en 2017, pour présenter ma candidature aux législatives, il m’a fallu cocher ma catégorie socio-professionnelle sur les formulaires officiels français : eh oui, aux yeux de l’État français, je suis… un « homme de lettres ». Circulez, ‘y a rien à voir !